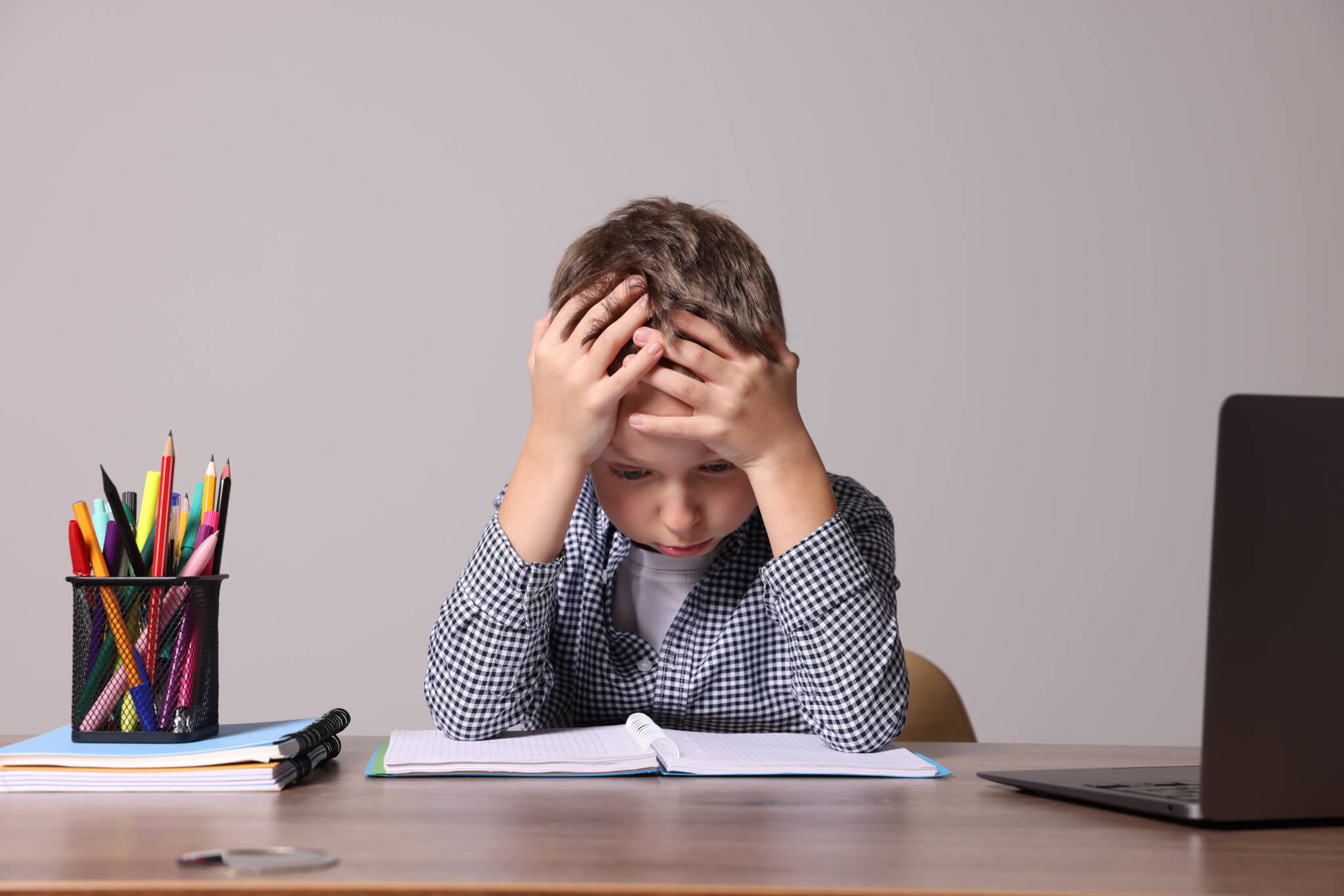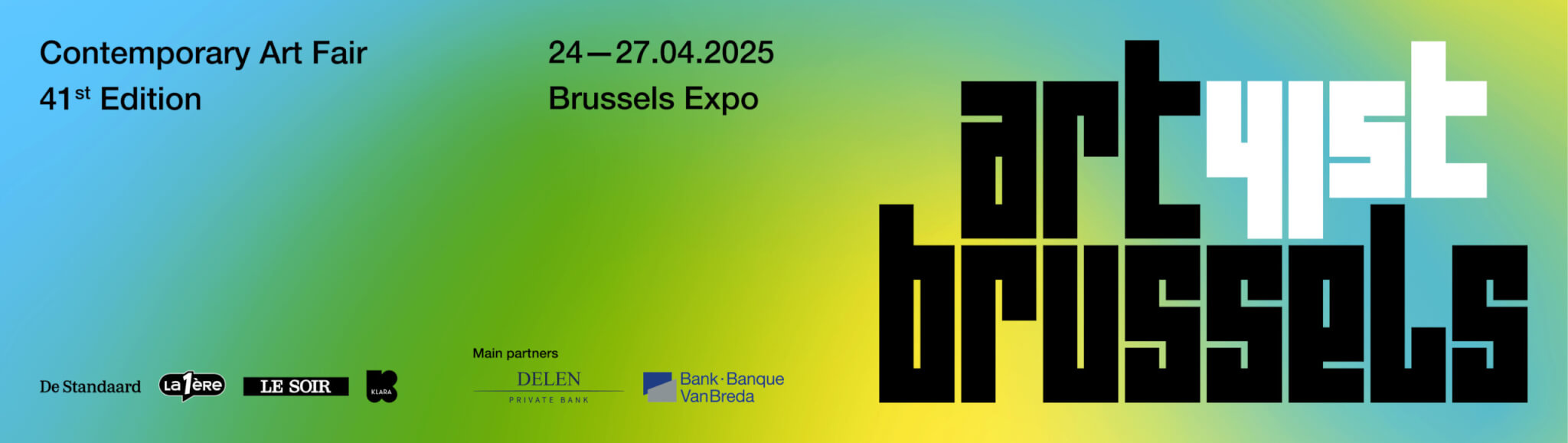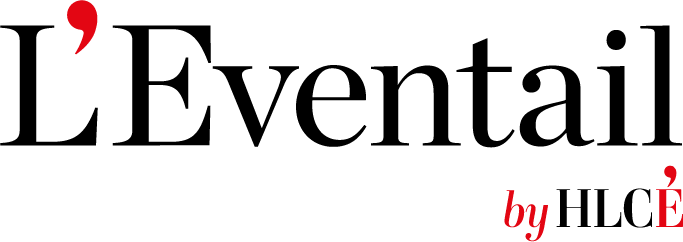Contre les troubles “dys” : bouger, parler et réfléchir !
Virginie Draelants
22 April 2025
Les troubles “dys” – dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc. – semblent plus répandus que jamais, au point de susciter interrogations et inquiétudes dans de nombreuses familles. Certains y voient une meilleure détection, d’autres pointent un environnement peu adapté ou des méthodes pédagogiques dépassées. Certains spécialistes estiment détenir des solutions. Bérénice André nous livre son approche, parmi de nombreuses pistes possibles.
On estime généralement qu’environ 5% des enfants dits “dyslexiques” présentent des bases génétiques, confirmées par IRM ; les 95% autres pourcent découleraient de l’environnement. “Dans la grande majorité des cas, les choses sont moins figées qu’on ne le croit, explique Bérénice André, enseignante et formatrice. L’environnement, le stress, la sédentarité ou les méthodes employées peuvent, selon moi, contribuer à la situation.” Quand les familles ou l’école constatent que l’enfant se décourage en lecture, confond certaines lettres ou éprouve d’importantes difficultés à orthographier, la tentation est grande de poser un diagnostic rapide. Pourtant, un bilan approfondi peut révéler qu’il s’agit moins d’une dyslexie irréversible que d’un besoin de rééducation phonologique et de stratégies d’apprentissage adaptées. La plasticité du cerveau, particulièrement chez le jeune enfant, offre ainsi des perspectives encourageantes.
La place centrale de la parole
L’une des pistes réside dans une pédagogie de la parole. “Quand l’enfant décrit tout haut ce qu’il est en train de faire, il mobilise l’aire de Broca, le centre nerveux permettant l’articulation du langage. Loin de l’habitude ou de la simple intuition, il devient acteur de ses apprentissages.” Cela peut passer par des jeux de phonologie ou de lecture à voix haute, où l’élève segmente les syllabes et s’entend les prononcer. On peut aussi l’inviter à verbaliser les étapes d’un exercice : “Je prends la pièce de puzzle, je vois que c’est le bonnet du personnage, je la mets ici”, etc. En sollicitant le langage oral, l’enfant renforce la conscience de ce qu’il fait et consolide les connexions nécessaires à la maîtrise de l’écrit.
Au-delà de la parole, la méthode Multi’mouv® consiste à mobiliser simultanément plusieurs sens : vue, ouïe, toucher, équilibre et proprioception, en intégrant un rythme (ex. les rebonds d’une balle) et une démarche réflexive (calcul mental ou description d’une action). Combiner mouvement, parole et réflexion favorise la réorganisation des aires du langage. “D’une manière générale, on manque de mouvement, constate Bérénice. Pourtant, le cervelet sert de carrefour entre le corps et la pensée. Solliciter le corps, via un lancer de balle rythmé ou des exercices d’équilibre, réveille des zones cérébrales propices à l’apprentissage.” La dimension ludique ou sportive séduit les enfants qui se prennent au jeu et acceptent davantage de répéter des séquences exigeantes. On peut ainsi associer un calcul mental à chaque rebond de balle ou faire épeler un mot tout en coordonnant bras et jambes.
Dépistage précoce & alliance avec la famille
Détecter rapidement un trouble spécifique reste essentiel, sans quoi l’enfant risque de développer une faible estime de soi. Les enseignants, s’ils sont formés, peuvent repérer certains signaux d’alerte : lenteur extrême en lecture, confusions de lettres répétées, mélange de sons. Dans ce cas, la famille est orientée vers un logopède ou un neuro-praticien. Bérénice André insiste cependant sur le rôle primordial de la coopération parents-école. “Si l’enfant travaille des stratégies de lecture ou de numération en classe, mais se retrouve devant des écrans toute la soirée, sans échange, le bénéfice est réduit.” Les parents peuvent fixer des balises pour l’usage de la tablette ou de la console (minuterie, règles fermes), et encourager l’enfant à répéter des exercices ludiques.
Gare à la sédentarité !
Les sorties, la grimpe dans les arbres, la corde à sauter et de simples jeux d’adresse avec un ballon permettent de reconnecter la motricité et la réflexion. Un exemple souvent cité concerne la “classe du dehors” : un jour par semaine, quels que soit la météo, tout le monde sort. On découvre le monde, on dédramatise la notion d’erreur, on bouge plus, et cela profite aussi aux élèves en difficulté, “les conflits sont nettement moins nombreux”, constate aussi Bérénice.
Plusieurs adaptations, à l’école et à la maison, peuvent aider un enfant qui présente des signes de dyslexie ou de dyscalculie :
- Verbaliser les consignes : l’enseignant répète calmement et s’assure que l’élève a compris, par exemple en lui demandant de reformuler.
- Accorder plus de temps : autoriser des pauses et des rythmes plus lents pour écrire ou résoudre des exercices.
- Varier la présentation : espacer le texte, user de codes couleurs…
- Encourager la coopération : l’élève demande de l’aide à un camarade ou explique lui-même ce qu’il a compris.
- Soutenir l’enfant dans la progression : pointer les progrès plutôt que souligner les fautes.
Gestion des émotions & de la confiance
Les élèves en difficulté risquent de glisser vers un sentiment d’échec, c’est pourquoi Bérénice André souligne l’importance de la bienveillance : fixer un cadre clair, mais valoriser l’effort. “Certains enfants, après plusieurs revers, bloquent. Or, si on leur montre qu’ils ont avancé, ne serait-ce qu’un peu, ils reprennent courage et veulent progresser.” Cette confiance restaurée peut passer par la communication positive et l’écoute des émotions : un enfant qui explose est peut-être en proie à une frustration ou à du mal à verbaliser un besoin. Apprendre à nommer ses émotions, respirer, se calmer aide à gérer le stress face aux tâches scolaires.
L’essentiel est de ne pas laisser l’enfant dans l’impasse. “Plus on tarde, plus c’est compliqué, constate Bérénice. Mais rien n’est jamais joué, même en fin de primaire on peut encore beaucoup faire, parce que le cerveau reste malléable.” Dans des classes de vingt-cinq élèves, les cours sont rarement donnés de manière différenciée ou individuelle, malgré la diversité des profils et les évolutions de la société. L’enjeu consiste peut-être à repenser l’organisation de la classe, laisser place au mouvement et à la parole et coopérer avec les familles.
La présence de troubles dyslexiques, dysorthographiques ou autres ne doit pas être vécue comme une fatalité. L’être humain apprend mieux lorsqu’il se sent en confiance, en mouvement et en interaction. Les neurosciences offrent une piste et apportent un éclairage, montrant l’importance du corps et de la parole pour stimuler la plasticité cérébrale. “Bouger, parler, réfléchir”, telle pourrait être la sainte trinité d’un apprentissage réussi.
À faire

- Phonologie quotidienne : jeux, lecture et exercices à haute voix
- Exercices de conscience du corps : équilibre, coordination…
- Verbaliser les démarches et découvertes : encourager le mouvement et la parole
- Apprendre sur des supports variés
- Faire en famille des jeux (de société) qu’apprécient les enfants et les parents
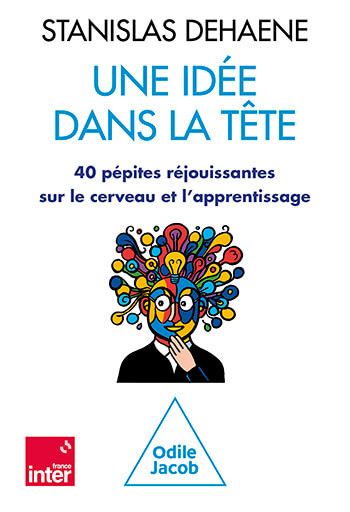
Une idée dans la tête
Pour prolonger la réflexion, on pourra lire avec profit Une idée dans la tête – 40 pépites réjouissantes sur le cerveau et l’apprentissage, le dernier ouvrage de Stanislas Dehaene, neuroscientifique spécialiste en psychologie cognitive, également auteur de La Bosse des maths (1996). Éd. Odile Jacob, octobre 2024, 240 p.
Photo de couverture : © New Africa, shutterstock.com