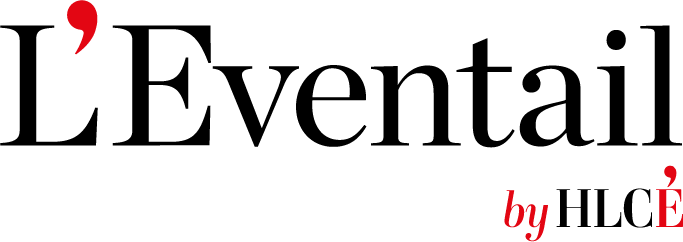Anne de Bourbon-Siciles, une princesse romancière
Rédaction Eventail
26 December 2014
Avec le Chant du Pipiri, Anne de Bourbon-Siciles a publié son premier livre, une histoire romanesque qui se déroule entre la Martinique, la France et l'Italie, trois pays qu'elle affectionne et connait bien. Bien éloignée de l'histoire que ses ancêtres ont forgée - n'est-elle pas une descendante des Bourbons d'Espagne et des rois des Deux-Siciles ? - , la fresque qu'elle a imaginée révèle un don de conteuse hérité d'une aïeule polonaise dont l'influence fut instrumentale. La Princesse partage avec nous la genèse de ce travail d'écriture qui débuta de façon inattendue et se poursuivit telle une aventure grisante, avec pourtant quelques moments d'incertitude.
L'Eventail - Madame, votre premier livre est un roman. Auriez-vous pu écrire un ouvrage historique ?
Anne de Bourbon-Siciles - Non, je ne le pense pas. Je ne suis pas historienne et comme je suis pudique et que je préfère ne pas parler de ma famille et de moi-même, ce n'était pas une bonne idée. Mais surtout, en choisissant cette option, je ne pouvais donner libre court à mon imagination qui est assez débordante. En fait, je souhaitais écrire un roman que j'aurais aimé lire. J'avais une grand-mère paternelle fantastique. Comtesse Zamoyski par naissance, elle était très fantasque et nous passions beaucoup de temps avec elle. Au quotidien, pour nous distraire et développer notre imagination, elle nous proposait deux jeux : soit inventer la vie des passants que nous croisions ou continuer une histoire qu'elle nous racontait. Quand nous ne savions plus quoi dire, elle reprenait le fil du récit et le ponctuait de choses un peu extraordinaires, comme des bals en Pologne par exemple...
- C'est donc un peu grâce à elle que l'idée d'écrire un roman vous est venue ?
- Oui, tout-à-fait. Je patientais dans une salle d'attente quand j'ai eu comme un déclic. Au lieu de m'énerver, j'ai fixé mon attention sur le tableau accroché en face de moi, une toile que j'ai depuis dans mon salon, et j'ai commencé à imaginer une histoire comme je le faisais avec ma grand-mère. Il s'agissait d'une femme blanche alanguie sur un sofa et d'un homme noir qui lui tient la main. Les idées ont commencé à se bousculer dans ma tête et, rentrée chez moi, j'ai écrit des heures et des heures, environ quarante pages, presque toute la trame du livre sans m'arrêter. Le lendemain matin, j'ai eu des doutes mais j'ai tout de même donné le manuscrit à mes enfants et à certains amis et leur enthousiasme m'a poussé à continuer. J'ai envoyé la trame et j'ai reçu une réponse positive des éditions archipel. Bien entendu, extraire 300 pages des quarante que j'avais écrites s'avérait être une autre paire de manches ! Cela m'a pris un an et demi avec des hauts et des bas. mais ce fut une expérience incroyable.
- Pourriez-vous nous parler du thème de ce roman ?
- Depuis quelques années, je partage ma vie entre Paris et la Martinique, ce qui m'a permis de découvrir cette île plus en profondeur. Au début, je n'avais pas les codes pour comprendre et je suis donc passée à côté de beaucoup de choses. Ce que je voulais dans ce roman, c'était dévoiler comment vivent les martiniquais. Au-delà de l'histoire d'amour, il y a donc de petits messages à décrypter, des années cinquante à nos jours, qu'il s'agisse des problèmes de mixité, des questions que les métis se posent ou du statut de la créolité. Au début, j'ignorais les tensions qui existaient toujours entre les descendants des esclaves et les descendants des colons, les békés. Je ne pensais pas qu'à notre époque, il y avait encore autant de distance entre eux et que, depuis l'abolition de l'esclavage, le compte n'était toujours pas réglé. En ayant l'air de rien, je souhaitais faire comprendre comment les choses fonctionnaient car. Il me fallait juste un déclic et cela s'est passé dans cette salle d'attente.

- Le titre a-t-il une signification ?
- Le pipiri est le premier oiseau qui chante le matin, un peu notre chant du coq. On se donne même rendez-vous au pipiri chantant, une expression que j'aurai voulu utiliser mais qui était déjà prise.
- Y a-t-il une part autobiographique dans ce roman ?
- C'est une fiction mais inévitablement, sans le vouloir, c'est vrai qu'il y a une partie de moi-même qui transparait dans le récit. Je me suis servie de lieux que je connaissais, de souvenirs aussi que j'ai intégré dans cette histoire.
- Vous semblez très attachée à la Martinique, qu'en est-il ?
- Oui, j'y vis maintenant plusieurs mois l'année. Je suis varoise de naissance, italienne de par ma famille et je crois martiniquaise d'adoption. Je suis née à Saint-Raphaël et j'ai grandi à la campagne dans la propriété viticole de mes grands-parents. Mon enfance fut très saine avec beaucoup d'amour, beaucoup de jeux et de rires. Pas question d'avoir la grosse tête ! Si je peux transmettre à mes enfants la moitié de ce que j'ai reçu, ils seront très chanceux. Nous sommes très complices, nous formons une sorte de mafia ensemble. Ma fille Dorothée est journaliste pour la télévision et mon fils Nicolas a repris une propriété agricole de famille. C'est un passionné de cuisine. Ma soeur Béatrice habite Neuilly et je la vois souvent. Nous nous téléphonons presque tous les jours. Quant à mon frère Carlos, il est chef de notre famille. Il se partage entre Rome et Monaco. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il accomplit avec l'Ordre constantinien dont il est le grand-maître. Je voudrais l'aider davantage mais sans être rebelle, j'aime ma liberté.
Vous aimerez peut-être
Publicité
Publicité