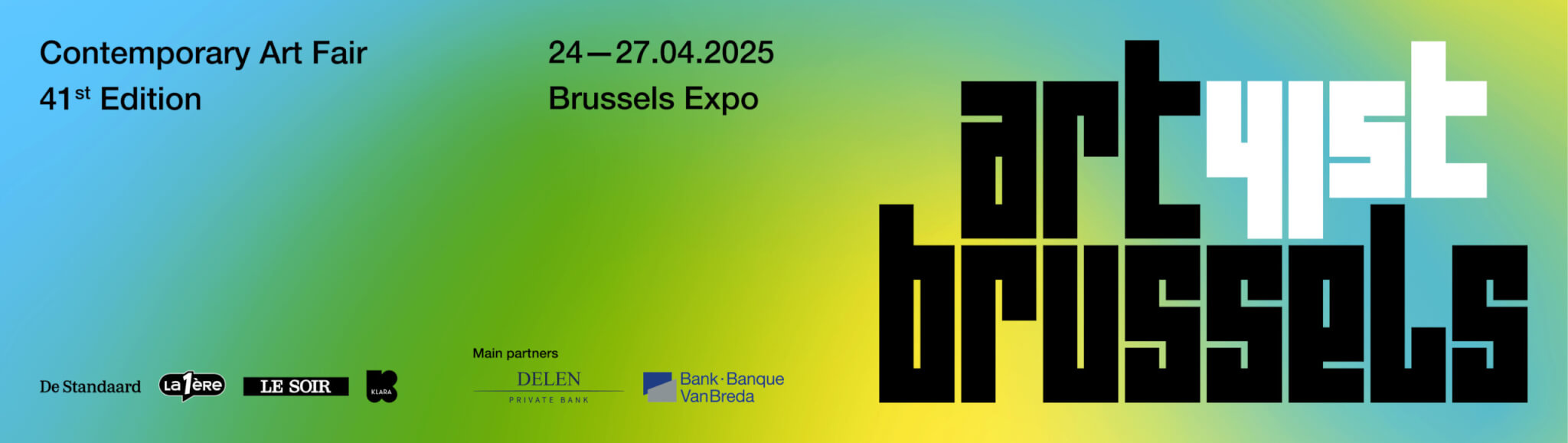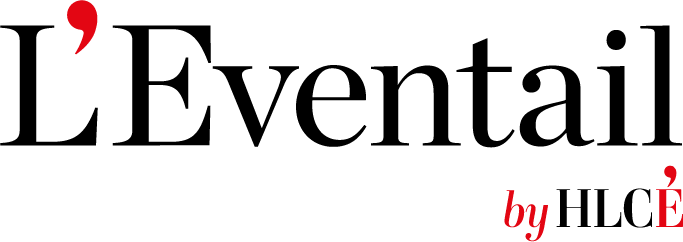Vendredi à la Berlinale
Rédaction Eventail
19 February 2016
« Alors, qu'en pensez-vous ? » : Je sors titubant du Berlinale Palast après les huit heures de projection de A Lullaby to the sorrowful mystery, et comme je suis un des premiers à quitter la salle trois télévisions (espagnole, allemande et italienne) se précipitent successivement sur moi pour recueillir mes impressions. Tout à coup, je me dis que ceux qui en 1876 venaient d'assister à Bayreuth à la première mondiale du Ring wagnérien devaient être dans le même état d'esprit: la stupeur et l'incrédulité.
Né en 1958, le réalisateur philippin Lav Diaz était jusqu'ici connu et admiré d'une poignée de cinéphiles. Le voici du jour au lendemain au centre d'un tourbillon médiatique, accueilli sur la scène avec son équipe comme un nouveau dieu du 7e art et honoré par un des plus illustres festivals du monde occidental. J'avais vu ici et là des films plus courts (tout est relatif : le précédent durait 5 h 30) de ce natif de Mindanao et j'avoue que j'avais été rebuté par ce qui m'apparaissait comme une assez arrogante posture auteuriste. Mais ici on a affaire à une œuvre parfaitement maîtrisée, qui impressionne par une immense ambition dont le cinéma du dernier quart de siècle offre peu d'exemples.
Le récit se situe entre 1896 et 1898, dans cette brève période où les Philippins se soulèvent contre le colonisateur espagnol. La première séquence évoque (sans la montrer) l'exécution du poète et héros national José Rizal (auteur d'un classique de la littérature philippine – d'ailleurs traduit en français – intitulé Noli me tangere). A partir de là, Lav Diaz développe une immense interrogation sur le rôle de l'individu dans l'histoire et sur le lien entre mythe et réalité dans une entreprise révolutionnaire. Attention : il ne s'agit absolument pas d'une grande saga guerrière avec affrontements épiques, chevauchées haletantes et conclusions triomphantes. Nous ne sommes pas dans un western de Sam Peckinpah, ni même dans un remake asiatique où l'on verrait l'équivalent de Fidel Castro et de ses barbudos crapahutant dans la Sierra Maestra. Il est bien question du leader de l'insurrection anti-hispanique Andres Bonifacio, mais on ne le voit pas un instant sur l'écran. Lav Diaz a pris le parti de refuser tout élément spectaculaire au profit d'une narration centrée sur quelques individus aussi peu héroïques que possible. La veuve de Bonifacio erre interminablement dans la jungle en espérant retrouver le corps de son mari; à ses côtés, un ex-révolutionnaire tuberculeux et un petit groupe de femmes perdent pied physiquement et moralement. Un ancien compagnon de Bonifacio, gravement blessé, accompagné d'un rebelle au rôle ambigu, s'égare lui aussi dans cette montagne de plus en plus impénétrable. Mais qu'on ne cherche pas la moindre logique dans les incidents qu'invente au fil des heures le cinéaste. Il règne dans son film un climat de folie généralisée. Et surtout, à mesure qu'on progresse dans le délire, la nature – sauvage, hostile, violente - devient un personnage à part entière. Pour nous plonger dans cet enfer (qui m'a fait plus d'une fois penser au Conrad des short stories Un Avant-poste du progrès et Au cœur des ténèbres), Lav Diaz invite un style totalement personnel. La lenteur est poussée ici à un degré invraisemblable. J'ai pensé à ce critique musical anglais qui disait que dans certains adagios des symphonies de Bruckner on avait le temps de voir l'herbe pousser. Dans A Lullaby, la caméra reste parfois immobile pendant plusieurs minutes alors qu'il ne se passe quasiment rien. En outre, Diaz fait table rase de presque toute la grammaire enseignée dans les écoles de mise en scène, comme s'il voulait revenir à l'innocence originelle du cinéma. Le format adopté est d'ailleurs celui des premiers films du 20e siècle. Refus des gros plans, dédain pour toutes les ressources que peut fournir le montage, prédilection pour les plans fixes. Et tournage en noir et blanc (avec tout de même un subtil travail sur la couleur). Mais quelle photo ! Il me semble que je n'ai plus vu quelque chose d'aussi magique depuis les chefs-d'oeuvre de l'expressionisme allemand (Murnau et compagnie).
Pour revenir à l'auteur de Parsifal, que j'évoquais en commençant, je dirais qu'il y a quelque chose de la volonté de puissance wagnérienne dans l'autorité avec laquelle Lav Diaz nous impose inexorablement sa vision. Et nous, spectateurs, n'avons d'autre choix (si nous ne quittons pas la salle, ce que fit à mon estimation un bon tiers du public de la Berlinale) que de nous soumettre masochistiquement à l'esthétique sans concessions du démiurge philippin. En sortant de la salle après les huit heures de projection, un ami berlinois me disait que pour lui la douleur et l'extase se confondent ici inextricablement. Quel que soit le choix final du jury présidé par Meryl Streep, on aura assisté au cours de cette 66e édition à un événement tel qu'on n'en vit que tous les dix ans dans un grand festival.
Vous aimerez peut-être
Publicité