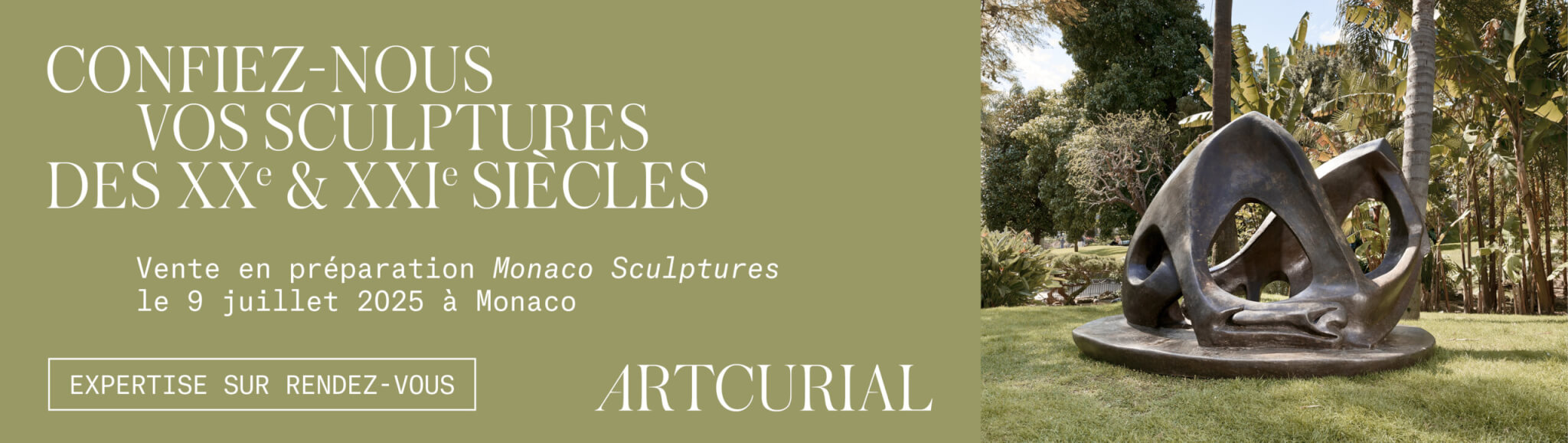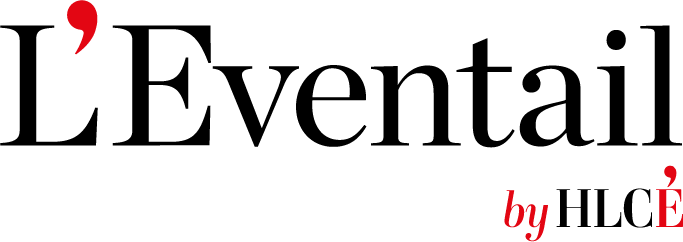5 bonnes nouvelles pour la planète
Rafal Naczyk
27 March 2025
Inondations meurtrières, incendies en plein hiver, augmentation de 1,5 °C de la température terrestre moyenne… Malgré un contexte environnemental alarmant, le monde regorge d’initiatives porteuses d’espoir. Des projets innovants et concrets fleurissent, démontrant qu’un avenir durable reste possible.
1. Le retour du lynx dans les Ardennes
© Jaycen
© Susy Baels
Le lynx boréal, ce félin majestueux aux yeux perçants et aux oreilles touffues, avait disparu des forêts ardennaises belges depuis plus d’un siècle, victime de la chasse et de la destruction de son habitat. Mais grâce aux efforts conjoints d’associations de protection de la nature comme Natagora et du programme européen LIFE Lynx, cet élégant prédateur a fait son grand retour. Depuis 2016, plusieurs individus ont été réintroduits dans les massifs forestiers de l’est de la Belgique. Alors que le félin avait disparu des radars depuis 2022, les premières naissances en liberté ont récemment été observées, signe que le lynx est en passe de reconquérir son territoire ancestral. Selon une étude commanditée par le WWF, les forêts belges pourraient accueillir 75 lynx. À condition, toutefois, de protéger et de restaurer plusieurs dizaines d’hectares de biotopes menacés. Au sein du Parc national de la vallée de la Semois, des efforts sont en cours pour restaurer et créer des habitats favorables. L’objectif est de réserver une centaine d’hectares de lisières et de zones ouvertes dans la forêt d’ici 2026. Avec leurs rochers escarpés, les pentes ardennaises sont idéales pour le repos et la reproduction du lynx.
2. L’agriculture urbaine revégétalise Bruxelles
© Yuri Photolife
Bruxelles, comme de nombreuses métropoles européennes, a décidé de prendre le virage de l’agriculture urbaine. Toits végétalisés, potagers communautaires, fermes verticales… Les initiatives se multiplient pour verdir la ville et produire des aliments frais et locaux. Des projets innovants voient le jour, comme BIGH (Building Integrated Greenhouses), qui intègre des serres dans les bâtiments, Rooftop Farms, qui transforme les toits en jardins productifs ou Cycle Farm, une ferme urbaine qui enseigne les secrets d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Imaginez : des légumes croquants cultivés sans pesticides, que vous pouvez cueillir vous-même, en famille ou entre amis. Ces initiatives permettent non seulement de rapprocher les citadins de la nature et de les sensibiliser à l’alimentation durable, mais aussi de renforcer la résilience alimentaire des villes face aux défis du changement climatique. L’agriculture urbaine contribue également à réduire de 11 à 15 % les émissions de CO2 liées au transport alimentaire. Enfin, même si Bruxelles vit sous la pluie, elle contribue à la création d’îlots de fraîcheur, réduisant ainsi le besoin de climatisation.
3. Les bisons des Carpates : superhéros pour le climat
© Bieszczady Wildlife
Après deux siècles d’absence, les majestueux bisons européens ont retrouvé leur place dans le sud des Carpates. En 2024, la Roumanie a réintroduit quatorze individus provenant de Suède et d’Allemagne sur son territoire. Ce retour, initié en 2014, est le fruit d’un ambitieux projet de réintroduction mené par le WWF et Rewilding Europe. Grâce à ces initiatives, plus de 200 bisons évoluent désormais en totale liberté au sein d’une vaste zone protégée de 150 000 hectares. Les Carpates sont la plus grande chaîne de montagnes d’Europe. Elles s’étirent sur cinq pays : Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Ukraine et Roumanie. Les forêts couvrent environ 50 % de cette région cruciale pour la conservation de la biodiversité en Europe. De vastes étendues de forêts – semi-naturelles, anciennes et primaires – y abritent nombre d’espèces endémiques, mais aussi les plus grandes populations de loups et d’ours bruns en Europe. Loin d’une simple réintroduction, ce projet a permis de restaurer un équilibre écologique ancestral. En effet, les bisons s’avèrent particulièrement bénéfiques pour l’environnement. D’après les chercheurs, rien qu’en Roumanie, les troupeaux de bisons permettent de capter 53 000 tonnes de CO2 par an, ce qui correspond à l’empreinte carbone de 123 voitures thermiques. Leur présence a aussi un impact régénérateur sur les écosystèmes forestiers et sur les prairies. Leur pâturage est très efficace : ils recyclent les nutriments, fertilisent les sols, dispersent des graines, stimulent la croissance des plantes et compactent la terre, ce qui empêche le carbone stocké d’être libéré dans l’atmosphère.
4. Plus de 1000 nouvelles espèces découvertes dans le monde
© Ronald Diaz
© ROBINSON OLIVERA, THE NEW YORK TIMES
Un poisson à “tête de goutte”, une souris semi-aquatique carnivore, une chauve-souris aux airs de licorne… Même à l’heure actuelle, notre planète continue de nous surprendre par la richesse de sa biodiversité. Récemment, plus de 1000 nouvelles espèces ont été découvertes dans le Bassin du Congo et la région du Grand Mékong. Parmi ces merveilles de la nature figurent des grenouilles arboricoles, des poissons arc-en-ciel et des serpents aux motifs hypnotiques. Ces découvertes, fruit du travail acharné de scientifiques passionnés, mettent en lumière l’importance de préserver ces écosystèmes fragiles et de poursuivre l’exploration de notre monde naturel, qui recèle encore bien des secrets. Mais les surprises ne s’arrêtent pas là. Au cœur de la forêt amazonienne péruvienne, dans la région d’Alto Mayo, l’ONG Conservation International a fait une découverte étonnante : vingt-sept nouvelles espèces animales, dont quatre nouveaux mammifères. Quarante-huit autres espèces attendent des analyses qui pourraient également confirmer leur nouveauté pour la science. Cette découverte, dans une zone d’Amazonie pourtant marquée par l’activité humaine et la déforestation, souligne la résilience de la nature et l’importance de protéger ces havres de biodiversité.
5. La Grande Muraille verte en Afrique : un rempart contre la désertification
© UNCCD
Face à l’avancée du désert, l’Afrique subsaharienne a lancé un projet ambitieux : la Grande Muraille verte (GMV). Ce projet titanesque a pour objectif de lutter contre la désertification, de séquestrer 250 millions de tonnes de carbone, de protéger la biodiversité, d’améliorer la sécurité alimentaire et de créer 10 millions d’emplois. À l’origine, ce projet initié en 2007 visait à créer une ceinture verte de 8000 kilomètres de long entre le Sénégal et l’Éthiopie, en plantant des arbres et en restaurant les terres dégradées. Mais au fil des années, le tracé de la GMV s’est étendu sur onze pays du Sahel et du Sahara abritant 430 millions de personnes, soit 32 % de la population africaine. Selon un bilan officiel dévoilé en décembre, près de 20 millions d’hectares ont été restaurés à ce jour et 350 000 emplois ont été créés. Notamment grâce à la pratique de l’agroforesterie. Financée par les Nations unies, des ONG internationales et la France, la Grande Muraille verte est un symbole de la résilience africaine et de la capacité des communautés locales à agir pour préserver leur environnement et construire un avenir durable. L’objectif est de restaurer plus de 5 millions d’hectares d’ici 2030.