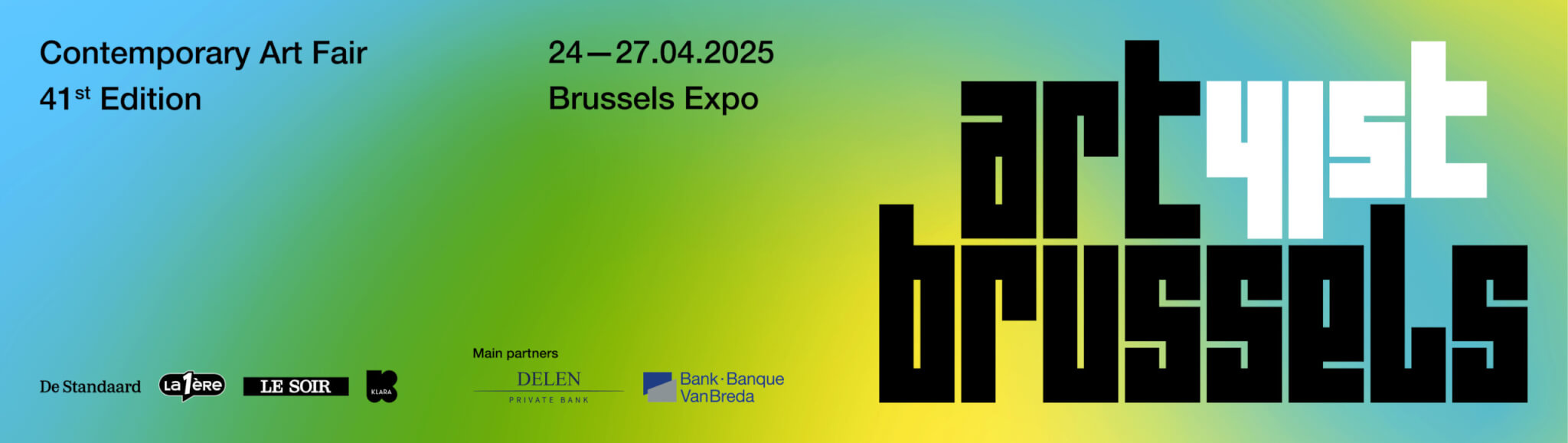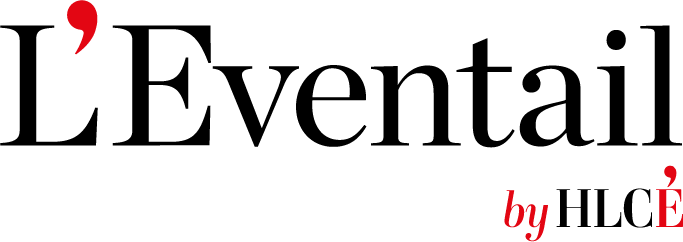Secret d'état à la Berlinale
Rédaction Eventail
18 February 2016
[caption id="attachment_15898" align="alignnone" width=""]Les cyber attaques sont les nouvelles guerres de ce monde[/caption]En 2010, des informaticiens de haut niveau ont découvert l'existence d'un programme ultra-secret intitulé Stuxnet, qui a permis de saboter le développement de l'industrie nucléaire iranienne. Dans son film Zero Days, présenté aujourd'hui à la Berlinale, le réalisateur américain Alex Gibney nous présente une enquête fouillée sur cette invention qui semble relever de la science-fiction et qui a pourtant été conçue par les agences (CIA, NSA et autres) de deux pays obsédés par la menace iranienne: les Etats-Unis et Israël.
Officiellement, le programme Stuxnet n'existe pas. On voit dans le film une série de responsables qui esquivent les questions du cinéaste ou se réfugient derrière le secret d'Etat. Le mystère qui entourait Stuxnet a pourtant été dissipé en partie par une enquête menée par un journaliste du New York Times, David Sanger, qui apparaît ici à plusieurs reprises. Si j'avais entendu parler de Stuxnet, j'avoue que j'ai appris dans Zero Days l'existence d'un programme qui donne littéralement froid dans le dos : sous le nom de code Olympic Games, c'est un méga-virus qui permettrait de paralyser entièrement l'infrastructure et les institutions (industrie, communication, commandement militaire) d'un pays ennemi. Nous sommes entrés, prévient Alex Gibney, dans l'ère des cyber-attaques, d'autant plus inquiétantes qu'elles se préparent à l'insu de la société civile (parlements, médias, etc). Le problème d'un film comme celui-ci, c'est qu'il s'agit de soutenir pendant 116 minutes l'intérêt du spectateur en lui montrant des myriades de chiffres, des graphiques et des écrans d'ordinateurs. Le premier quart d'heure de Zero Days m'a paru assez aride, et j'ai failli décrocher. Le récit devient progressivement moins aride, avec des séquences d'archives et des quantités d'interviews (qui ont parfois un côté involontairement comique quand des responsables militaires et politiques de haut rang se réfugient dans la langue de bois et s'obstinent à nier des évidences). Même s'il nous éclaire sur les formes terrifiantes que pourrait prendre un conflit entre états, le documentaire d'Alex Gibney risque fort de passer par-dessus la tête du spectateur lambda et d'alimenter en priorité les discussions entre spécialistes de la géostratégie.
Avec Kollektivet (La Commune), le réalisateur danois Thomas Vinterberg, âgé aujourd'hui de 46 ans, s'est replongé, nous dit-il, dans ses souvenirs de jeunesse pour élaborer le scénario de ce récit qui évoque une des plus pathétiques utopies soixante-huitardes : la vie en communauté. Un architecte qui vient d'hériter d'une vaste maison dans la banlieue aisée de Copenhague se laisser persuader par sa femme, journaliste de télévision, de partager la demeure avec une bande d'amis plus ou moins fauchés. Comme on pouvait s'y attendre, l'expérience de vie en commun, commencée dans la rigolade et les soûleries collectives, ne tarde pas à tourner à l'aigre. Surtout quand l'architecte - personnage au demeurant assez veule et couard - s'éprend d'une jeune étudiante qu'il introduit dans le phalanstère (avec l'assentiment initial de son épouse). Le rêve d'une vie libérée des conventions s'achève dans les pleurs et la désillusion. Je dois dire que cette œuvre polyphonique (il y a une bonne demi-douzaine de personnages, adultes, adolescents et enfants) n'a pas tardé à m'irriter, dans la mesure où j'y ai vu un drame psychologique plutôt conventionnel et souvent prévisible. Vinterberg a été à la fin des années 1990 un des fondateurs, avec Lars von Trier, de l'éphémère mouvement Dogma, qui voulait redonner au cinéma une sorte de pureté originelle.
Le film-manifeste de ce petit groupe, tourné précisément par Vinterberg, a été le fameux Festen. Mais Dogma n'est plus qu'un souvenir, et ses initiateurs ont suivi des chemins différents, bien éloignés de leurs ambitions juvéniles. S'il y a d'excellents acteurs dans Kollektivet, si certaines scènes ne manquent pas de punch, et si le personnage de l'épouse est traité avec justesse, je suis sorti de la projection en me disant que ce psychodrame scandinave ne me laissera pas de grands souvenirs.
Vous aimerez peut-être
Publicité